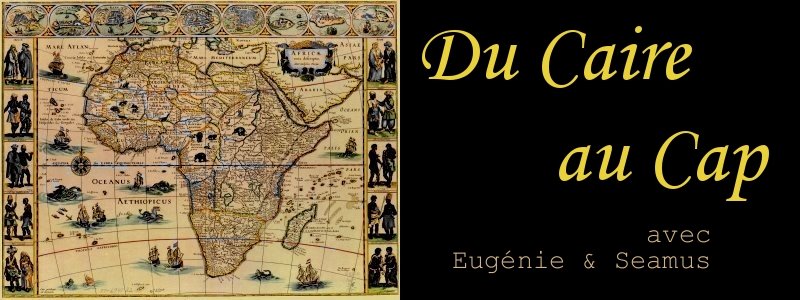A bird siren dances about my street. But of what rare form or species I couldn’t say.  On my street, all is kept for privacy and left not to the passing judgment of onlookers with digital cameras in hand. This is an island where too much has been given away, so what secrets it holds, it clings to tirelessly. Zanzibar has never known a time when outsiders didn’t come in great numbers to profit from its bounties and its serenity. Come to conquer, to inhabit, to steal and enslave, to colonize, to hide away, to impose themselves upon. From the first settlements of Swahili people, the Persian and Arab empires, the Portuguese traders, the Indian settlers, the English colonials, and the masses of post-colonial travelers, seekers, business people, development workers and tourists who flock here each year – Zanzibar has had its entire history imported. Everything else was dragged in boatloads off the island to everywhere else around the globe. So what remains now intact must remain so, for the sake of the people who still remain here.
On my street, all is kept for privacy and left not to the passing judgment of onlookers with digital cameras in hand. This is an island where too much has been given away, so what secrets it holds, it clings to tirelessly. Zanzibar has never known a time when outsiders didn’t come in great numbers to profit from its bounties and its serenity. Come to conquer, to inhabit, to steal and enslave, to colonize, to hide away, to impose themselves upon. From the first settlements of Swahili people, the Persian and Arab empires, the Portuguese traders, the Indian settlers, the English colonials, and the masses of post-colonial travelers, seekers, business people, development workers and tourists who flock here each year – Zanzibar has had its entire history imported. Everything else was dragged in boatloads off the island to everywhere else around the globe. So what remains now intact must remain so, for the sake of the people who still remain here.
 Stonetown, the capital of the island, was known as the spice capital of the world for centuries. There was a time when boats arriving in the harbor could not smell the sea or the fish, as the scent of cloves in distilleries and nutmegs ground at the port consumed every other trifling odor with the greatest ferocity. Karibuni Zanzibar! And still today, though the distilleries have closed and have been left rotting in their skins about the north-end markets of the harbor, the careful constructions (of every great architectural style) still carry the evidence from their days of epic lore. And in every shop on every street, such as on my own, you should find illustrious collections of vanilla, massala, saffron, spiced teas and coffees, cloves, oils and herbs. The breeze from the ocean mixes with the scents of each as it whiffs through the stone block streets and green squares. Just another manifestation of the islands phantoms and charms.
Stonetown, the capital of the island, was known as the spice capital of the world for centuries. There was a time when boats arriving in the harbor could not smell the sea or the fish, as the scent of cloves in distilleries and nutmegs ground at the port consumed every other trifling odor with the greatest ferocity. Karibuni Zanzibar! And still today, though the distilleries have closed and have been left rotting in their skins about the north-end markets of the harbor, the careful constructions (of every great architectural style) still carry the evidence from their days of epic lore. And in every shop on every street, such as on my own, you should find illustrious collections of vanilla, massala, saffron, spiced teas and coffees, cloves, oils and herbs. The breeze from the ocean mixes with the scents of each as it whiffs through the stone block streets and green squares. Just another manifestation of the islands phantoms and charms.

There may or may not be a name for my street, and even if there were, not one local would be able to tell you where it was by giving them its name. You must know the community and reference them if you are to find your way here. When it rains, the dense stone streets quickly flood and the old men who have no more work to do rush with brooms and sticks to the closest drain holes to rapidly clear them as they become clogged with the neglected odds and ends about the streets edges. The buildings are glued  tightly at every seam and rarely extend beyond three or four floors. Occasionally you can find neighbors conversing about their rooftops over fresh passion fruit juice and soothing breezes.
tightly at every seam and rarely extend beyond three or four floors. Occasionally you can find neighbors conversing about their rooftops over fresh passion fruit juice and soothing breezes.
If I were to leave Stonetown to the north, I would probably end up living in one of the kilometers of gigantic socialist blocks built during the beginning of Nyerere’s presidency, separated quite minutely every so often by a walkway of grass and sand. But here in the old center we enjoy our old refinements.  Our hand-carved wooden doors centuries old. These doors are usually adorned with ornate metal spikes jetting from their faces (a style imported from India meant to stop Indian elephants from entering the homes). Our lattice and vinery. Our ancient baobabs jetting from the soft stones in our squares. The virtuosity of our daily prayers. The dangers of a bazaar’s mazes and the haunting echoes of our faiths skipping about them. But this life is fading, even with the support of Unesco, as the mainland has imposed tougher restrictions and higher taxes on account of Zanzibar’s popularity. Shops and homes are slowly replacing their weathered doors with generic steel plates and homes have begun copying a bland homogeny which has long affected cities in the rest of the world. My street has little to give of its own these days. Even its original craft forms have been substituted by Indian and Chinese made copies. The colorful tissues and wooden bead works are all tagged brightly in Kanji characters, as are many of the boxes of fruits in the market.
Our hand-carved wooden doors centuries old. These doors are usually adorned with ornate metal spikes jetting from their faces (a style imported from India meant to stop Indian elephants from entering the homes). Our lattice and vinery. Our ancient baobabs jetting from the soft stones in our squares. The virtuosity of our daily prayers. The dangers of a bazaar’s mazes and the haunting echoes of our faiths skipping about them. But this life is fading, even with the support of Unesco, as the mainland has imposed tougher restrictions and higher taxes on account of Zanzibar’s popularity. Shops and homes are slowly replacing their weathered doors with generic steel plates and homes have begun copying a bland homogeny which has long affected cities in the rest of the world. My street has little to give of its own these days. Even its original craft forms have been substituted by Indian and Chinese made copies. The colorful tissues and wooden bead works are all tagged brightly in Kanji characters, as are many of the boxes of fruits in the market.
 My street, just wide enough for the push carts and scooters which push their ways through the schoolchildren and vendors, raises her lips at the sides. It is here that men drink coffee and ginger infusions, where women avoid the floods, where one recollects themselves amidst the unsettling bustle of shop hours. It seems at times as if all larger groups of bodies pulse intermittently and somewhat unpredictable down the slick rock-lined veins and alleys. The school children go in shifts, and the daily parades to the mosques are of course roughly timed. But you never know when you may need to avoid a monstrous mob of mzungus or when the chains of men pushing goods through the maze may decide to use your street to bypass another. And at each hidden nook, tucked away between a series of otherwise identical doors, will surely be a small restaurant to stop for soup, sweet beans and juice; always full.
My street, just wide enough for the push carts and scooters which push their ways through the schoolchildren and vendors, raises her lips at the sides. It is here that men drink coffee and ginger infusions, where women avoid the floods, where one recollects themselves amidst the unsettling bustle of shop hours. It seems at times as if all larger groups of bodies pulse intermittently and somewhat unpredictable down the slick rock-lined veins and alleys. The school children go in shifts, and the daily parades to the mosques are of course roughly timed. But you never know when you may need to avoid a monstrous mob of mzungus or when the chains of men pushing goods through the maze may decide to use your street to bypass another. And at each hidden nook, tucked away between a series of otherwise identical doors, will surely be a small restaurant to stop for soup, sweet beans and juice; always full.  But everything begins to close at sun down. Excepting the streets full of shops for tourists, or those booming with high-end eateries and late night markets, nothing of the day remains after dark. The street empties and hushes as each thick door is firmly sealed. The darkness floods the paths, illuminated only by the glowing white galabia’s sweeping through from time to time followed by the delayed but pleasant pleasantries of dear men. Children and women mostly stay indoors unless accompanied to the buffet gardens at the sea port for a delightful social stroll before retiring again. It’s only your neighbors in the evening to discuss the politics of island life and the rigors of work with. And at night, my street is a place of idyllic peace and calm. Here, those who live here would not allow it to be any other way. Not, that is, until morning when the bird siren’s dance is expected again.
But everything begins to close at sun down. Excepting the streets full of shops for tourists, or those booming with high-end eateries and late night markets, nothing of the day remains after dark. The street empties and hushes as each thick door is firmly sealed. The darkness floods the paths, illuminated only by the glowing white galabia’s sweeping through from time to time followed by the delayed but pleasant pleasantries of dear men. Children and women mostly stay indoors unless accompanied to the buffet gardens at the sea port for a delightful social stroll before retiring again. It’s only your neighbors in the evening to discuss the politics of island life and the rigors of work with. And at night, my street is a place of idyllic peace and calm. Here, those who live here would not allow it to be any other way. Not, that is, until morning when the bird siren’s dance is expected again.

Un oiseau chante dans ma rue, il est difficile de savoir à quoi il ressemble car ce dernier ne sort que rarement de son nid dissimulé sous un toit. Il fredonne et siffle des notes mélodiques et différentes en fonction de l’heure et de la température. La journée commence tôt dans ma rue, il faut dire que cette dernière est située en plein cœur de Stonetown, la ville-capitale de l’île de Zanzibar située dans l’Océan Indien. Ma rue qui n’a pas de nom est pavée de pierres plates, quand il pleut trop, ma rue, comme presque toutes celles de Stonetown est inondée. Il faut alors remonter son pantalon et s’avancer dans les ruelles détrempées. Les maisons sont toutes collées les unes aux autres et attiegnent rarement plus de trois étages.
 Au delà du vieux centre ville les belles maisons se font plus rares. Les barres d’immeubles en béton, réminiscence de la politique socialiste de l’ancien président Nyerere s’alignent sur des kilomètres, les cocotiers plantés juste à coté apparaissent soudainement ridiculement petits. Quelques unes des portes de ma rue sont de véritables chefs d’œuvre d’ébénisterie, certaines ont plus de 150 ans. Elles symbolisaient à l’époque de la traite négrière la richesse et la prospérité de celui qui la franchissait quotidiennement. Ces dernières sont magnifiquement sculptées et décorées de petits boutons de métal de formes variées. L'idée vient d'Inde où les portes étaient par endroit
Au delà du vieux centre ville les belles maisons se font plus rares. Les barres d’immeubles en béton, réminiscence de la politique socialiste de l’ancien président Nyerere s’alignent sur des kilomètres, les cocotiers plantés juste à coté apparaissent soudainement ridiculement petits. Quelques unes des portes de ma rue sont de véritables chefs d’œuvre d’ébénisterie, certaines ont plus de 150 ans. Elles symbolisaient à l’époque de la traite négrière la richesse et la prospérité de celui qui la franchissait quotidiennement. Ces dernières sont magnifiquement sculptées et décorées de petits boutons de métal de formes variées. L'idée vient d'Inde où les portes étaient par endroit  ornées de clous destinés à dissuader les éléphants d'entrer dans les cours intérieures. A Zanziabr, de telles portes abritent souvent des maisons ou des monuments historiques. Les échoppes quand à elles sont plus souvent dissimulées derrières des portes modernes sans grand intérêt.
ornées de clous destinés à dissuader les éléphants d'entrer dans les cours intérieures. A Zanziabr, de telles portes abritent souvent des maisons ou des monuments historiques. Les échoppes quand à elles sont plus souvent dissimulées derrières des portes modernes sans grand intérêt.
Ma rue n’a pas de trottoir mais une petite margelle qui s’étend sur les deux cotés, un toit en taule permet de couvrir ces dernières qui protègent les piétons du soleil ou de la pluie. Ma rue n’a rien de touristique, elle ressemble à celle qui lui succède, il n’y a ni palais ni quoique ce soit pour attirer les curieux, elle est l’unes de ces rues dans laquelle il est agréable de déambuler le nez en l’air. Ma rue est trop étroite pour laisser circuler les voitures mais les vélos, les scooters et les charrettes y passent sans cesse. Il faut d’ailleurs toujours rester sur ses gardes, à chaque intersection peut se cacher un véhicule foncant à tout allure.  Alors que l’île kenyane de Lamu est un paradis pour les ânes, Zanzibar est un éden pour les moto-bicyclettes. Ma rue compte de nombreux commerces, souvent les vendeurs sont assis sur une chaise installée sur le parvis, ils observent ce monde qui bouge en attendant les clients. Les boutiques de mode sont nombreuses, l’on y vend du 100% made in China, des tenues à paillettes pour petite fille et des robes larges. Les sacs à main et les bijoux de pacotilles occupent une grande partie de la vitrine qui scintille. Souvent des groupes de femmes voilées s’engouffrent dans l’un de ces lieux à grand bruit, elles en ressortent les bras chargés ou bien vides. Ma rue abrite une véritable caverne d’Ali Baba, une échoppe faite de boiseries sombres. Des cartons et des paniers sont empilés sur différents niveaux. On vient ici acheter toutes les épices et les écorces possibles et imaginables, des noix de muscade rondelettes, de l’encens, des gousses de vanille séchées et des huiles en tout genre. Un grand drapeau à l’effigie de l’équipe anglaise Manchester United est accroché à la porte mais disons plutôt que c’est le discret écriteau « vanilla aviaible » qui attire l’œil. De ce magasin s’échappe une odeur d’épice et de renfermé qui envahie ma rue en fonction des vents qui s’y engouffrent.
Alors que l’île kenyane de Lamu est un paradis pour les ânes, Zanzibar est un éden pour les moto-bicyclettes. Ma rue compte de nombreux commerces, souvent les vendeurs sont assis sur une chaise installée sur le parvis, ils observent ce monde qui bouge en attendant les clients. Les boutiques de mode sont nombreuses, l’on y vend du 100% made in China, des tenues à paillettes pour petite fille et des robes larges. Les sacs à main et les bijoux de pacotilles occupent une grande partie de la vitrine qui scintille. Souvent des groupes de femmes voilées s’engouffrent dans l’un de ces lieux à grand bruit, elles en ressortent les bras chargés ou bien vides. Ma rue abrite une véritable caverne d’Ali Baba, une échoppe faite de boiseries sombres. Des cartons et des paniers sont empilés sur différents niveaux. On vient ici acheter toutes les épices et les écorces possibles et imaginables, des noix de muscade rondelettes, de l’encens, des gousses de vanille séchées et des huiles en tout genre. Un grand drapeau à l’effigie de l’équipe anglaise Manchester United est accroché à la porte mais disons plutôt que c’est le discret écriteau « vanilla aviaible » qui attire l’œil. De ce magasin s’échappe une odeur d’épice et de renfermé qui envahie ma rue en fonction des vents qui s’y engouffrent.

De nombreux passants circulent dans ma rue. Des écoliers en tenues assorties les unes aux autres aux heures stratégiques ou des groupes d’adolescents qui chahutent. Les indiennes aux cheveux tressés portent toujours leurs indémodables saris et les femmes plus âgées portent parfois ces capes d’un autre âge.  Le vendredi les hommes sont beaucoup plus nombreux à revêtir leurs galabyas d’une blancheur parfaite. Les magasins ferment parfois quelques minutes dans la journée, le propriétaire prend alors le chemin de la mosquée pour répondre à l’appel du muezzin avant de revenir quelques minutes plus tard. Il est très facile de connaitre tous les habitants de ma rue, ces derniers sont toujours ravis de discuter quelques minutes tous les matins, même quand il est impossible de se comprendre. Un petit recoin abrite une maison aux portes toujours ouvertes, des femmes y cuisinent toute la journée et vendent des bols de soupe et des chipsi. A l’heure de la sortie de l’école les enfants du quartier s’y retrouvent et comparent les petites pièces qu’ils tiennent dans leurs mains en attendant leur commande. Les murs de ma rue comptent quelques graffitis décolorés et des affiches aux couleurs des différents partis politiques élimées par le temps. Il n’y a pas un seul vendeur de légumes. De temps à autres passe une charrette chargée de produits frais et d’une balance, il s’agit de ne pas rater de coche sous peine de devoir se rendre au marché.
Le vendredi les hommes sont beaucoup plus nombreux à revêtir leurs galabyas d’une blancheur parfaite. Les magasins ferment parfois quelques minutes dans la journée, le propriétaire prend alors le chemin de la mosquée pour répondre à l’appel du muezzin avant de revenir quelques minutes plus tard. Il est très facile de connaitre tous les habitants de ma rue, ces derniers sont toujours ravis de discuter quelques minutes tous les matins, même quand il est impossible de se comprendre. Un petit recoin abrite une maison aux portes toujours ouvertes, des femmes y cuisinent toute la journée et vendent des bols de soupe et des chipsi. A l’heure de la sortie de l’école les enfants du quartier s’y retrouvent et comparent les petites pièces qu’ils tiennent dans leurs mains en attendant leur commande. Les murs de ma rue comptent quelques graffitis décolorés et des affiches aux couleurs des différents partis politiques élimées par le temps. Il n’y a pas un seul vendeur de légumes. De temps à autres passe une charrette chargée de produits frais et d’une balance, il s’agit de ne pas rater de coche sous peine de devoir se rendre au marché.  Vers 18 heures les échoppes commencent à fermer dans ma rue, les cintres sont rangés et les parvis balayés, les portes ne rouvriront que demain matin.
Vers 18 heures les échoppes commencent à fermer dans ma rue, les cintres sont rangés et les parvis balayés, les portes ne rouvriront que demain matin.
Ma rue prend fin mais une autre tout aussi similaire lui succède. Cette dernière, parce qu’elle compte au moins trois magasins pour touristes est moins agréable. Le passant à la peau blanche a de très fortes chances d’entendre « welcome, karibu, free looking madam » à chacun de ses passages. A quelques habitations de la mienne officie le maitre de ma rue. Sa double porte en bois grande ouverte abrite une petite table sur laquelle trônent deux thermos, quatre bocaux avec des allumettes et du henné ainsi qu’une dizaine de petites tasses. L’homme vêtu d’une chemise et d’une petite calotte sert du café et des infusions de gingembre. Quand le soleil est trop fort il sort ses Ray-Ban qui lui vont à merveille. Ce dernier est toujours ravi de voir passer des clients et le montre bien en souriant à pleine dents alors qu’il n’en a plus que quelques unes. Le petit café ouvre tôt dans l’après midi et veille tard le soir, il devient alors la seule attraction de ma rue bien loin des restaurants branchés. Il attire les voisins, les enfants et quelques curieux de passage alors que la ville s’endort lentement.