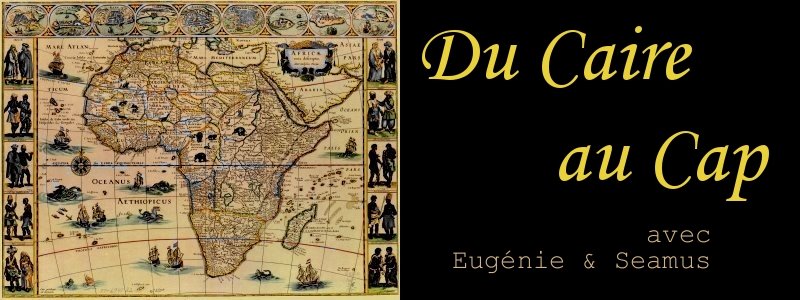We had been told of the old bridge in Jinja; that it was a perfectly beautiful walk between the town and Njeru Bukaya where we were staying. From the bridge, it was said you could see all the gardens, the dam, the Nile, and generally the beauty the place was supposed to offer. “Fifteen minutes walk to town, that’s all!” We had the morning free, so we decided to take the stroll.
Immediately arriving at the bridge, and noticing the enthusiastic grimace of the two drunken military officers at the base when the turned to each other and spat the word muzungu, I knew exactly the following order of events which would soon unfold. We must have been merely fifteen meters onto the bridge when Eugénie casually (and without pausing I might add), leaned coolly over the rail to view the rushing twinkles of current below. One officer screamed for us to stop, but Eugénie was convinced he told us “not to stop,” so we continued walking. Five seconds later a monstrous roar to “stop right there,” came from his direction. We halted, looked at each other full awareness of the situation, and waited for him to reach us.
“Who sent you here?”
"No one.”
“Who told you to look at the water?”
The questions which followed, though barely comprehensible as both his English was poor and his tongue too languid from the harsh scented waragi (gin-like liquor sold in plastic bags very cheaply), were of the sort of logic one derives to detain someone until the pedestrians close-by are further from ear-shot. I suggested that we were late and would like to continue walking over the bridge. He informed us that he would be escorting us.
“Where are you staying?”
“With a friend.”
“I’d like to be your friend,” he says with an impudent tone.
“We prefer friends who don’t aggress us.”
The machinegun he was carrying carelessly suddenly stiffened, cocked, and he moved behind us telling us that we were going to leave him with our money.
“I’m not giving you a bribe.” I said. Bad idea. I used the “word” first!
The following thirty minutes consisted of us playing stupid, playing with his half-wits, trying to keep other pedestrians close as he made us sit under the bridge and listen to an aggressive lecture. We stayed clear on our position and eventually, he pulled another bag of waragi from his pocket, opened it, and told us we could go.
These happenings are fairly frequent, though not as often as we would have expected after reading forums of travel in Africa before we left. This was however our first time in Uganda having any such trouble (in contrast to our stay in Kenya). We, following the advice of many Kenyans who believe that there is no point to report these incidences since their advisors are even more corrupt, took to ignoring it and complaining just to our friends. Our friends in Uganda felt it necessary to go to the police. Especially since so many young female volunteers use the bridge as their route to town, and they may be less capable of handling the aggression than we. But to even walk by a police station after such an incident, we felt so distrustful that it was safe to report “like-brethren in uniform”. We passed the station three times before finally going inside.
Inside the station, we were sent down a long corridor, past medieval-esque iron cells with dozens of arms stretching out of seeking help, keys, and trouble. The office we entered was full to the ceiling with paperwork and six or so officers recording by hand different cases. We were seen by Officer Charles, who was adorable and fatherly. He was so shocked by our story, and so apologetic for our experience. He was worried we had lost trust in Ugandan people. It took maybe an hour of slowly recording our story by hand, then hand writing a formal complaint with red ink. It was quite amusing to us, the experience of our first police station in Africa. We left the station and returned home over the same bridge (this time accompanied by a boda driver walking his motorbike for protection). It was felt good, even if nothing was to come of the complaint, to have an officer apologize for another. The next time it happens, I will gladly make a visit to Charles.
Our receipt of complaint from Officer Charles / Reçu de plainte de l'officier Charles
Tout le monde s’accorde à dire que la traversée du pont piéton qui relie Njeru - Bukaya à Jinja est une promenade idéale sur le Nil. « 15 minutes de marche ! Du pont vous pouvez voir le barrage, des jardins sur le Nil et les pêcheurs lanceurs de filets ! ». Allons-y ! Nous avons le temps en cette matinée ensoleillée. A peine arrivés aux pieds du pont, les deux militaires avachis à l’ombre, mitraillettes de coté et sachet de gin à la main murmurent déjà « muzungu » sourire en coin. Petit rappel, muzungu est le terme raciste préféré des populations pour désigner tout ce qui ne leur ressemble pas - chinois, africain à la peau plus ou moins foncée qu’eux, latinos, et européens. Quinze mètres plus tard une fois sur le dit pont une idée absolument déraisonnable me prend : et si je m’arrêtais quelques secondes pour regarder l’eau qui défile et les oiseaux qui virevoltent. Un officier hurle alors « stop » alors que naïvement j’entends « don’t stop », nous poursuivons donc notre route. Quelques secondes plus tard le même homme réitère son admonestation « stop right there ! » tout en s’avançant dans notre direction. Nous partageons un profond soupire en attendant l’arrivée du soldat de plomb.
- « qui vous envoi ici ? » demande t-il.
- « personne » répond t- on de manière hésitante face à cette question surprenante.
- « qui vous a dit de regarder l’eau ? » ajoute t-il alors.
Les questions qui suivent n’ont absolument aucuns sens. Son anglais est a peu prêt aussi aléatoire que celui d’un enfant qui tente d’être sérieux en argumentant dans une langue qu’il ne maîtrise pas. Laissons le déblatérer, cela aura au moins l’avantage de l’occuper quelques instants. Nous lui faisons alors comprendre que n’ont n’avons ni le temps ni l’envie de rester d’avantage sur ce pont. Il nous informe alors qu’il va nous escorter jusqu’à destination.
- « où habitez-vous ? » poursuit t- il alors ?
- « chez un ami » répond – on froidement.
- « j’aimerai moi aussi être votre ami » ajoute t-il.
- « nous n’avons pas besoin d’un nouvel ami aussi agressif ».
Il change alors sa mitraillette d’épaule, met son doigt sur la gâchette et arme l’engin qu’il met bien en évidence sous nos yeux.
- « You are going to leave me with money? » demande t-il alors?
- « tu reçois un salaire du gouvernement alors non, je ne vais pas te laisser de bakchich » répond Seamus.
Quelle idée, mais quelle idée, le mot « bribe », l’ultime erreur !
- « Comment ! Vous essayez de m’acheter avec un bakchich ? Comment ?! », s’exclame t-il faussement surpris.
La demi-heure qui suit est plus ou moins une pièce de théâtre où l’homme exprime à haute voix son désarroi : des étrangers ont tenté de lui donner un bakchich. Il nous fait alors assoir sous le pont mais n’a rapidement plus rien à ajouter. Son collègue qui ouvre alors son second sachet de waragi, la fameuse liqueur, reste coi. Nous appliquons règle de base : ne jamais rester seuls dans les mains d’un policier, d’un militaire (ou de ce qui porte un uniforme et une mitraillette), des passants s’arrêtent à notre demande et observent la scène, ce qui ne va pas pour arranger les deux militaires.
Selon les guides et forums de voyage, ce genre de petit incident est monnaie courante. Nous sommes plutôt surpris par le fait qu’à l’exception des policiers kenyans, personne ne s’est jamais comporté de la sorte. Si vous écoutez un kenyan il vous dira « il n’y a rien à faire, même ceux qui s’occupent des questions de corruptions sont corrompus jusqu’aux os ». Mais en Ouganda nos amis on insistés, vous devez vous plaindre à la police. Voilà l’occasion parfaite pour découvrir la police locale !
Le petit commissariat de Jinja se trouve dans un vieux et beau bâtiment d’angle. Des agents en tenue kaki discutent ou se promènent sur le parvis. Les deux réceptionnistes ne comprennent pas bien notre requête
- « vous venez déclarer un vol ?» demandent –elles sont même nous écouter.
- « non on vient déclarer un abus commis par un militaire ».
Direction le bureau 12, au fond du couloir. Le corridor extérieur est bordé de salles aux portes en bois branlantes et aux écriteaux dégarnis. Il est tellement difficile de lire le chiffre 12 sur la porte que l’on décide d’y aller à l’instinct. La prison du commissariat est pleine à craquer, des dizaines de prisonniers, bras tendus vers l’extérieur demandent de l’aide ou même les clés de la cellule qui les enferme.
La salle 12 compte six bureaux, autant d’officier et des piles de papiers jaunis et cousus à la main pour en faire des dossiers. Les affiches et les plans de la ville accrochés aux murs sont en phase avancée de décomposition. Charles, officier chaleureux et paternel vêtu d’un costard cravate nous reçoit à son bureau logé derrière la porte. Il ne cesse de s’excuser, désolé, en expliquant : « vous savez c’est très rare dans le pays, les ougandais sont vraiment des gens gentils ». Il écoute notre histoire avec passion avant de prendre le temps de retranscrire nos mots à l’encre rouge avec une application sans égale, il ajoute même un plan détaillé du pont et de nos avancées. Nous relisons les feuilles qui sont ensuite agrafées. Charles quitte la pièce avec le document avant de revenir avec un morceau de papier indiquant son nom et le numéro de notre dossier. Qui sait peut être que dans quelques années, il fera encore partie des archives.